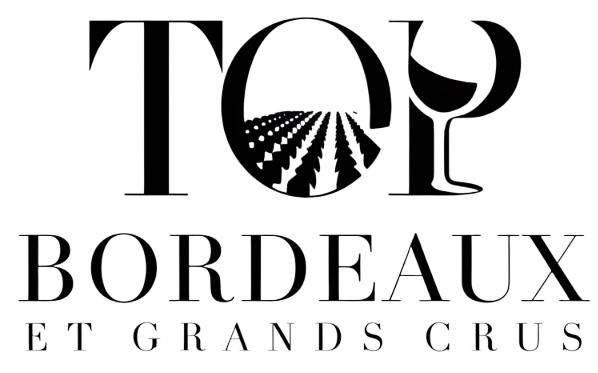L’art de l’assemblage : le cœur battant des grands vins de Bordeaux
Dans l’imaginaire collectif, Bordeaux évoque la puissance, l’élégance et la longévité. Mais derrière ces qualités, une pratique façonne discrètement l’identité de ces vins depuis des siècles : l’assemblage. À l’inverse...