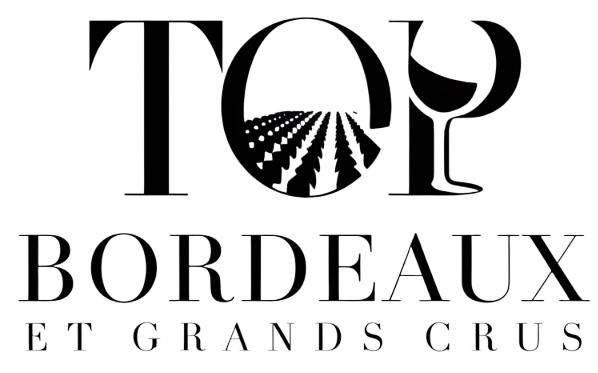L’assemblage : le secret de la complexité aromatique dans les grands vins de Bordeaux
L’assemblage est une pratique ancestrale au sein des vignobles bordelais, guidée autant par l’intuition du vigneron que par une connaissance rigoureuse des cépages et du terroir. Si le mot peut paraître technique, il s’agit...