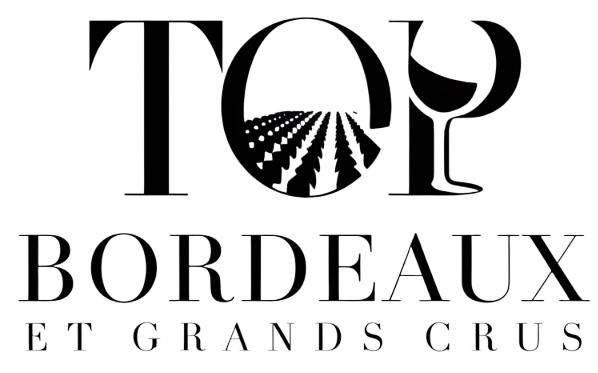L’art de l’assemblage : le secret de la longévité des grands vins de Bordeaux
Inséparable de l’identité bordelaise, l’assemblage, ou « blend », est bien plus qu’une signature stylistique. C’est un savoir-faire qui façonne la structure, la complexité et la capacité de garde des vins. Si la plupart des r...