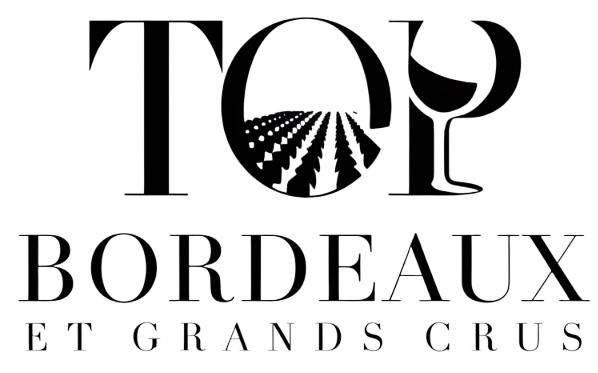Vieillissement des vins de Bordeaux : les secrets derrière la magie du temps
Tous les vins ne sont pas faits pour vieillir. Dès la vigne, de nombreux paramètres déterminent leur capacité à évoluer avec élégance : structure tannique, acidité, concentration en extraits, équilibre des cépages, rôle du terroir… C...