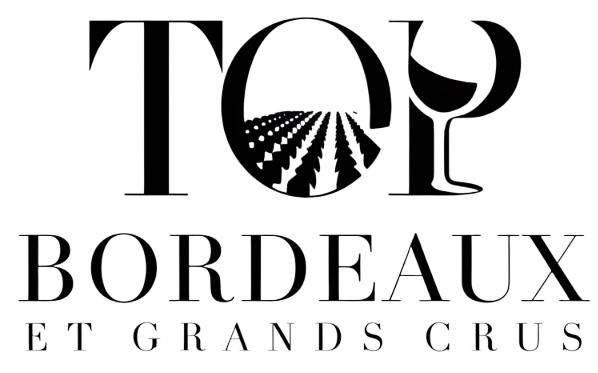Les guerres et crises économiques : des épreuves qui ont façonné le vignoble bordelais
17 mars 2025
Le Moyen Âge : l'influence anglaise et les prémices d’un vignoble stratégique
C’est au cours du Moyen Âge que Bordeaux commence à s’imposer comme un acteur clé du vin en Europe. À partir du XIIe siècle, l’union d’Aliénor d’Aquitaine et d’Henri II Plantagenêt propulse la région dans l’orbite anglaise. Les Bordelais bénéficient alors de privilèges commerciaux : les taxes sur les vins locaux sont réduites, favorisant leur exportation massive vers l’Angleterre. En parallèle, la "Guerre de Cent Ans" (1337-1453) affaiblit le commerce, et certaines vignes bordelaises sont abandonnées ou détruites au gré des conflits.
Mais la chute de Bordeaux aux mains des Français, en 1453, marque un nouveau départ. Les vignerons reculent face à ces bouleversements, mais pas pour longtemps. Dès le XVIe siècle, on assiste à un retour en force des vignobles bordelais grâce à la renaissance du commerce maritime.
Les ravages de la Révolution française et des guerres napoléoniennes
La fin du XVIIIe siècle marque une période noire pour Bordeaux. La Révolution française bouleverse l’ordre établi et frappe de plein fouet la viticulture. Les nobles propriétaires des grands domaines, souvent guillotinés ou exilés, voient leurs propriétés confisquées et pillées. Les châteaux, alors symboles de richesse et de pouvoir, tombent parfois en ruine.
Cette situation s’aggrave avec les guerres napoléoniennes (1803-1815). Avec le blocus continental imposé par Napoléon, les exportations vers l’Angleterre, principal marché des vins de Bordeaux, s’effondrent. Le vin s’accumule dans les chais, et les vignerons bordelais doivent redoubler d’efforts pour survivre économiquement. Il faudra attendre le milieu du XIXe siècle pour que Bordeaux retrouve son rayonnement commercial, notamment grâce au fameux classement des vins de 1855, qui élève certains crus au rang de légendes.
La crise phylloxérique : un désastre sans précédent au XIXe siècle
La fin du XIXe siècle apporte une nouvelle plaie au vignoble bordelais : le phylloxéra. Apparue pour la première fois en France en 1863, cette maladie, causée par un minuscule insecte, attaque et détruit les ceps de vigne en s’attaquant aux racines. Rapidement, les vignobles de Bordeaux, à l’instar du reste du territoire français, sont dévastés. En moins de deux décennies, la quasi-totalité des vignes bordelaises est touchée.
La solution vient des États-Unis, avec l’introduction de porte-greffes américains résistants au phylloxéra. Mais cette technique, longue et coûteuse, bouleversera durablement la composition du vignoble bordelais, avec notamment un recours accru au cépage cabernet sauvignon. Malgré ce cataclysme, Bordeaux entrevoit une renaissance au début du XXe siècle, juste avant de subir de nouvelles épreuves mondiales.
Les guerres mondiales : une époque de déclin et de privations
Le XXe siècle, avec ses deux guerres mondiales, inflige un coup dur au vignoble bordelais. Durant la Première Guerre mondiale (1914-1918), de nombreux vignerons partent au front, laissant leurs vignes à l’abandon. De plus, la mobilisation de l’économie vers l’effort de guerre limite la production viticole et complique le commerce international.
La Seconde Guerre mondiale (1939-1945), elle, accentue encore davantage les difficultés. L’occupation allemande impose des réquisitions et des quotas de production sévères. Certaines propriétés doivent fournir leurs vins à l’armée allemande, souvent à des tarifs dérisoires. Autre conséquence, l’effondrement du commerce maritime coupe Bordeaux de ses marchés internationaux pendant plusieurs années.
Cependant, ces sombres périodes incitent plusieurs domaines à innover, notamment en expérimentant de nouvelles techniques de vinification ou en replantant des cépages adaptés aux conditions climatiques et économiques d’après-guerre.
La Grande Dépression et la crise économique mondiale
Les années 1930, marquées par la Grande Dépression, frappent particulièrement les vignobles français. À Bordeaux, des stocks importants de vin s’accumulent, faute de débouchés commerciaux. Les prix s’effondrent, et de nombreux petits producteurs se retrouvent endettés. Dans ce contexte, certains abandonnent même leur activité viticole.
C’est également durant cette période que certains organismes de régulation et de protection voient le jour, notamment l’appellation d’origine contrôlée (AOC). Cette innovation, initiée dans les années 1930, est une réponse directe aux méfaits économiques de la crise et vise à revaloriser les terroirs en garantissant la qualité et l’origine des vins produits.
La crise viticole des années 1970 et le choc pétrolier
Si Bordeaux a traversé de nombreuses crises dans l’histoire moderne, celle des années 1970 s’inscrit comme un tournant. Le premier choc pétrolier (1973) provoque une hausse généralisée des coûts, impactant les marges des vignerons. En parallèle, les goûts des consommateurs changent et certains vins bordelais, perçus comme trop "traditionnels", perdent de leur superbe face aux nouveaux vins du "Nouveau Monde" (Californie, Australie, etc.).
Mais, là encore, Bordeaux tire son épingle du jeu. L’arrivée de consultants œnologues, tels qu'Émile Peynaud, révolutionne l’approche qualitative des vins. Les techniques modernes de vinification et d’élevage raffinées permettent à Bordeaux de regagner peu à peu sa place de leader mondial.
Résilience et réinvention : les leçons de l'histoire
L’histoire viticole bordelaise est donc jalonnée d’épreuves, mais aussi d’une étonnante résilience. Chaque crise a conduit les vignerons à s’adapter, que ce soit en expérimentant de nouvelles techniques, en façonnant des appellations ou en entamant des démarches commerciales plus audacieuses.
Aujourd’hui, alors que le vignoble bordelais doit également relever les défis environnementaux et climatiques, ces leçons du passé résonnent comme une source d’inspiration. Elles rappellent que, même dans les périodes les plus sombres, le terroir bordelais peut se réinventer et continuer de séduire les amateurs de grands vins à travers le monde.