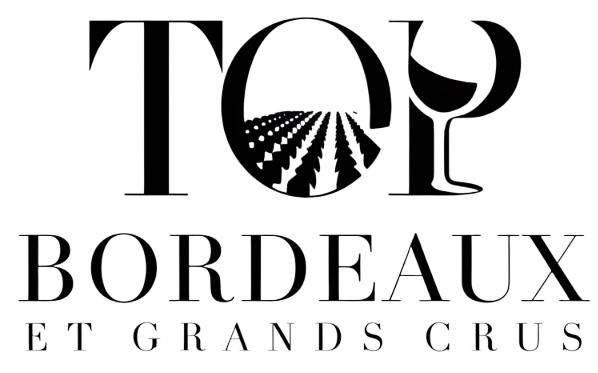Les moments clés de l’histoire qui ont sculpté le commerce des vins de Bordeaux
18 février 2025
Le mariage d’Aliénor d’Aquitaine et Henri Plantagenêt (1152) : la genèse de l’exportation vers l’Angleterre
Tout commence au XIIe siècle, lorsque le destin de Bordeaux s’entrelace avec celui de la couronne d’Angleterre. En 1152, le mariage entre Aliénor d’Aquitaine et Henri Plantagenêt, futur roi d’Angleterre, marque le début d’une période où la Gascogne, et donc Bordeaux, passe sous le contrôle anglais. Ce contexte politique va devenir un véritable tremplin pour le commerce des vins de Bordeaux.
À cette époque, les Anglais développent un goût prononcé pour le claret, ce vin rouge léger qui deviendra l’ancêtre des vins bordelais contemporains. Les relations commerciales entre Bordeaux et l’Angleterre s’intensifient, facilitées par l’accès direct aux ports de la Gironde. Les registres montrent qu’au début du XIVe siècle, près de 100 000 tonneaux de vin bordelais étaient exportés chaque année vers l’Angleterre.
Cet engouement pour les vins bordelais installe les bases de leur succès à l’export, un héritage qui persiste encore aujourd'hui.
Le privilège bordelais : un avantage fiscal et commercial décisif
Au fil des siècles, les Bordelais ont su tirer parti de leur position stratégique sur l’estuaire de la Gironde pour protéger et développer leur commerce. Une étape clé fut l’instauration du privilège bordelais accordé par les rois d’Angleterre puis par les rois de France.
Ce privilège, en vigueur jusqu’au XVIIIe siècle, conférait aux marchands de Bordeaux un monopole commercial. Les vins des régions voisines, comme ceux du Médoc ou du Bergerac, ne pouvaient être vendus sur le marché ou expédiés hors du port de Bordeaux tant que les vins locaux n’avaient pas trouvé preneur. Cette mesure favorisa grandement la prospérité des vignerons bordelais et renforça leur position dominante sur les marchés étrangers.
Impact économique
- Le privilège bordelais a encouragé la création de grands domaines viticoles, certains existants encore aujourd’hui.
- Il a permis à Bordeaux de concentrer les richesses et d’investir dans ses infrastructures, notamment ses quais pour le commerce maritime.
Cependant, ce monopole généra aussi des tensions avec les régions viticoles voisines, faisant naître une rivalité encore perceptible dans certains esprits.
Le classement de 1855 : l’ascension des grands crus
Sautons dans le temps jusqu’au XIXe siècle, une période où Bordeaux renforce sa position très enviable sur le marché des vins de qualité. En 1855, à l’occasion de l’Exposition universelle de Paris, Napoléon III demande un classement officiel des meilleurs crus bordelais. Ce classement hiérarchise les propriétés en fonction de leur renommée, de la qualité de leurs vins et des prix pratiqués à l’époque.
- Il distingue 61 grands crus classés parmi les vins rouges, répartis de la 1re à la 5e catégorie, avec la mythique catégorie des premiers crus dont Lafite Rothschild, Latour, Margaux et Haut-Brion.
- Pour les vins blancs doux, issus de Sauternes et Barsac, 27 crus sont classés.
Ce classement, encore en vigueur aujourd’hui avec peu de modifications, participe à la notoriété mondiale des vins de Bordeaux. Les acheteurs, notamment étrangers, y voient une garantie d’excellence, ce qui booste les exportations vers de nouveaux marchés, comme les États-Unis et la Russie au XIXe siècle.
La crise du phylloxéra (fin XIXe siècle) : une épreuve historique
Dans l’histoire de la viticulture bordelaise, le XIXe siècle reste aussi marqué par l’une des pires catastrophes : la crise du phylloxéra. Cet insecte minuscule, arrivé d’Amérique dans les années 1860, détruit les racines des vignes européennes. En moins de deux décennies, il ravage presque la totalité du vignoble bordelais.
Cette crise force les vignerons à repenser leurs pratiques. La solution ? Greffer les cépages bordelais sur des porte-greffes américains résistants à ce fléau.
- Le phylloxéra a accéléré les recherches agronomiques et encourage le recours à la collaboration entre viticulteurs et scientifiques.
- Cette innovation a permis de sauver le vignoble bordelais et de poser les bases d’une viticulture plus résiliente.
Cette période difficile montre aussi la capacité de Bordeaux à surmonter les défis, un trait essentiel pour un vignoble d’excellence.
Les révolutions modernes : du négoce international aux routes maritimes
Le XXe siècle voit Bordeaux se tourner vers de nouveaux horizons pour son commerce. Plusieurs innovations ont marqué cette période de transformation :
- Les maisons de négoce : le rôle des négociants s’intensifie, permettant aux vins bordelais de s’implanter en Asie, en Amérique et au-delà. Aujourd’hui encore, 70 % des vins de Bordeaux passent par ces réseaux bien rodés.
- Les routes maritimes : le port de Bordeaux modernise ses installations, facilitant les exportations dans le monde entier.
- La coopération entre producteurs : la création des appellations d’origine contrôlée (AOC) en 1935 donne un cadre réglementaire strict aux vins bordelais, renforçant leur position de marque haut de gamme.
Enfin, l’avènement des classements "modernes" comme celui des crus bourgeois dans le Médoc ou celui des graves en 1953 vient compléter l’univers bordelais en valorisant de nombreuses propriétés jusque-là moins reconnues.
Ouverture : l’héritage éternel des événements historiques
Du mariage d’Aliénor d’Aquitaine au négoce international, chaque époque a laissé une empreinte indélébile sur le commerce des vins de Bordeaux. Ces événements ne sont pas des anecdotes isolées : ils forment un récit cohérent qui explique l’attrait irrésistible des amateurs pour les bouteilles bordelaises.
Le commerce des vins de Bordeaux est aujourd’hui le fruit d’une alchimie entre tradition et innovation, un équilibre précieux qui lui permet de rayonner sur tous les continents. En tant qu’amateurs, nous buvons tous un peu de cette histoire à chaque verre dégusté. Alors, la prochaine fois que vous rencontrerez un Bordeaux, souvenez-vous qu’au-delà de la dégustation se cache tout un passé à célébrer.