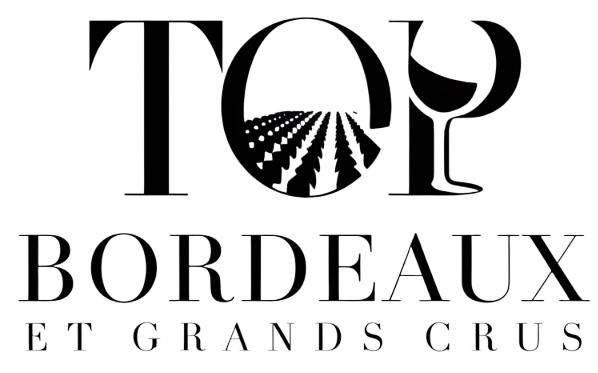En quoi le concept de « terroir » est-il fondamental pour l’identité des vins bordelais ?
Le terme de « terroir » dépasse la simple idée de terre ou de sol. Il désigne une combinaison complexe et subtile de facteurs naturels et humains qui influencent la vigne et, in fine, le vin produit. Voici les...